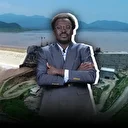Entre Washington et Pretoria, un bras de fer s’engage autour de l’AGOA, un accord commercial devenu un levier stratégique dans la lutte d’influence mondiale. Derrière les chiffres du commerce se cache une bataille pour le pouvoir, la souveraineté et la place de l’Afrique dans la nouvelle géoéconomie mondiale.
Un accord né d’une ambition américaine
Adopté en mai 2000 sous l’administration de Bill Clinton, l’African Growth and Opportunity Act, ou AGOA, visait à renforcer les échanges économiques entre les États-Unis et l’Afrique subsaharienne.
Le programme permet à plus de trente pays africains d’exporter des produits vers le marché américain sans droits de douane, à condition de respecter certaines exigences liées à la gouvernance, à la démocratie et à la libéralisation économique.
L’objectif initial était de stimuler le développement du continent par l’ouverture commerciale et d’intégrer les économies africaines dans la mondialisation.
En théorie, l’AGOA devait être un catalyseur de croissance, mais dans la pratique, ses effets se sont révélés inégaux. Tandis que certains pays comme le Kenya, l’Éthiopie ou le Lesotho ont développé de solides industries textiles, d’autres n’ont jamais réussi à tirer parti des avantages offerts, faute d’infrastructures adaptées ou de capacités de production suffisantes.
L’Afrique du Sud, un acteur incontournable
Au sein de ce programme, l’Afrique du Sud occupe une place singulière. Première puissance industrielle du continent, Pretoria a fait de l’AGOA un pilier de sa politique commerciale avec les États-Unis.
Ses exportations de véhicules, de produits métalliques et de denrées agricoles bénéficient largement de cet accès préférentiel.
Mais cette relation repose sur un équilibre fragile. Les différends tarifaires et les tensions diplomatiques entre les deux pays se multiplient, notamment sur les questions de politique étrangère.
Washington reproche à Pretoria sa proximité avec la Chine et la Russie, tandis que l’Afrique du Sud revendique une position de neutralité dans un monde qu’elle perçoit comme multipolaire.
Pour le gouvernement sud-africain, l’enjeu n’est pas seulement économique. Il s’agit aussi de défendre la souveraineté industrielle et l’emploi local, tout en continuant à profiter du marché américain. L’Afrique du Sud se trouve donc dans une position délicate, cherchant à préserver ses intérêts sans renoncer à son indépendance diplomatique.
Une bataille d’influence entre Washington et Pékin
Au-delà des chiffres du commerce, l’AGOA est devenue un instrument de la rivalité sino-américaine en Afrique.
Les États-Unis utilisent cet accord comme un outil d’influence pour contrer la présence économique grandissante de la Chine, dont les investissements massifs dans les infrastructures africaines redessinent la carte des alliances.
Face à la montée en puissance de Pékin, Washington cherche à maintenir sa présence économique, mais aussi son influence politique. En conditionnant l’accès au marché américain à des critères de gouvernance, les États-Unis tentent d’imposer leurs valeurs tout en consolidant leur rôle sur le continent.
Cette logique, perçue comme néocoloniale par certains observateurs africains, alimente un débat croissant sur la souveraineté économique du continent.
De son côté, la Chine avance sans condition politique explicite, offrant des prêts et des infrastructures en échange de matières premières.
Entre ces deux approches, l’Afrique tente de trouver une voie équilibrée, consciente que sa position stratégique attire toutes les convoitises.
L’avenir incertain d’un accord symbolique
Le 30 septembre 2025 devait marquer la fin officielle du programme AGOA. Sa prolongation, encore débattue à Washington, divise les partenaires. Certains plaident pour une reconduction immédiate, d’autres pour une refonte complète afin de mieux correspondre aux nouvelles réalités économiques et géopolitiques.
Trois scénarios se dessinent : une prolongation sans changement, une réforme profonde incluant de nouveaux secteurs et une dimension climatique, ou bien un remplacement pur et simple par un cadre commercial multilatéral.
Dans tous les cas, l’Afrique du Sud, en tant que principal exportateur du continent vers les États-Unis, sera au cœur des discussions.
Le choix que fera Pretoria sera déterminant, non seulement pour son économie nationale, mais aussi pour la position future de l’Afrique dans le système commercial mondial.
Une opportunité pour repenser la souveraineté africaine
Au-delà de la diplomatie et des intérêts économiques, l’AGOA pose une question essentielle : celle de la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale. Faut-il continuer à dépendre d’accords bilatéraux asymétriques ou renforcer les mécanismes continentaux comme la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf) ?
De nombreux économistes africains estiment que le continent doit désormais parler d’une seule voix. En misant sur l’intégration régionale, la transformation industrielle et la valorisation locale des ressources, l’Afrique pourrait négocier d’égal à égal avec ses partenaires extérieurs.
Ainsi, l’avenir de l’AGOA dépasse largement le cadre d’un simple traité commercial. Il s’agit d’un test pour l’autonomie stratégique africaine, un moment où le continent peut redéfinir ses relations avec les grandes puissances et affirmer sa capacité à tracer sa propre voie dans un monde en mutation.
En fin, le débat autour de l’AGOA révèle l’évolution des rapports de force mondiaux. Entre Washington, Pékin et Pretoria, l’Afrique devient un champ d’influence stratégique, mais aussi un espace d’opportunités pour qui saura en maîtriser les règles.
Dans un monde où la puissance ne se mesure plus seulement par l’économie mais aussi par la capacité à fixer les normes, l’Afrique du Sud et ses partenaires africains doivent choisir entre la dépendance et la souveraineté, entre la continuité et la refondation.