
- 14.02.2026, samedi
- 18:21
Les nouveaux équilibres du commerce mondial et la position de la Türkiye
17:4531/07/2025, Perşembe
MAJ: 31/07/2025, Perşembe
Article suivant
Ömer Faruk Doğan
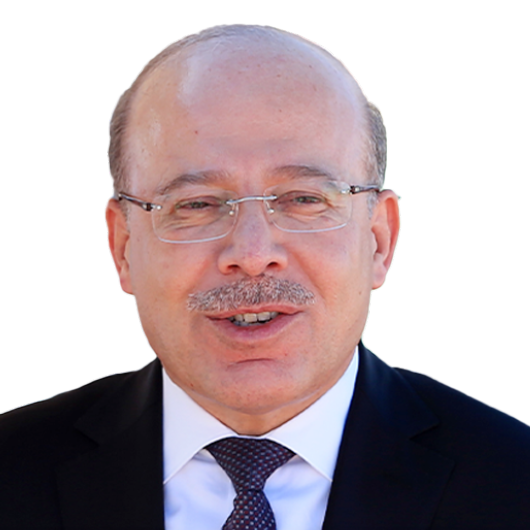
Le commerce mondial, d’une valeur de 24 000 milliards de dollars, a été ébranlé par la décision du président américain Donald Trump, annoncée le 2 avril 2025, d’imposer des droits de douane supplémentaires à 182 pays, dans le cadre d’une nouvelle politique visant à restructurer l’économie des États-Unis, combler les déficits budgétaires et rétablir l’équilibre de la balance commerciale extérieure.La décision d’appliquer des taxes supplémentaires, qui visait au départ uniquement le Mexique, le Canada
Le commerce mondial, d’une valeur de 24 000 milliards de dollars, a été ébranlé par la décision du président américain Donald Trump, annoncée le 2 avril 2025, d’imposer des droits de douane supplémentaires à 182 pays, dans le cadre d’une nouvelle politique visant à restructurer l’économie des États-Unis, combler les déficits budgétaires et rétablir l’équilibre de la balance commerciale extérieure.La décision d’appliquer des taxes supplémentaires, qui visait au départ uniquement le Mexique, le Canada et la Chine, a été élargie pour s’étendre à 182 pays.
Les droits de douane comme outil de négociation
Les droits de douane comme outil de négociation
Les décisions prises par Trump sont mises en œuvre dans le but de contraindre les pays concernés à entrer en négociation. Comme l’illustre le cas de la Chine, les taux de droits de douane ont parfois été relevés, tandis que dans le cas de l’Union européenne, ils ont parfois été reportés. Même si Trump formule parfois des déclarations qui peuvent sembler contradictoires, il poursuit sa stratégie en suivant la ligne directrice qu’il avait établie dès le départ. Trump a d’abord tendu l’atmosphère en haussant le ton face à la Chine.
Toutefois, après plusieurs séries de négociations, il est parvenu à apaiser les tensions liées aux droits de douane, aboutissant à un accord temporaire, sinon durable, avec Pékin. Ce compromis avec son principal rival commercial a permis aux États-Unis de desserrer l’étau tout en montrant aux autres pays qu’une solution alternative restait possible.
Les deux principaux leaders commerciaux qui façonnent le commerce mondial et occupent la première place ont élargi leur alliance en intégrant le Japon, dans le but de redéfinir le commerce mondial. Ces deux pays, représentant environ 35 à 40 % du commerce mondial, ont ainsi ajouté un troisième pays technologique d’Asie de l’Est à leur cercle.
Les États-Unis ont garanti les investissements japonais d’une valeur de 550 milliards de dollars présents sur leur sol, en échange d’un tarif douanier de 15 % sur les produits japonais. De son côté, Tokyo a accepté d’ouvrir son marché aux États-Unis pour les voitures, pickups, le riz ainsi qu’une série d’autres produits agricoles et articles secondaires. Par cette entente, l’administration Trump a franchi une étape importante dans ce dossier. Il est probable que de nombreux pays d’Asie de l’Est suivent prochainement l’exemple de cet accord commercial conclu entre le Japon et les États-Unis.
Accord entre les États-Unis et l’Union européenne
Accord entre les États-Unis et l’Union européenne
Cette situation a contraint les pays n’ayant pas encore entamé de négociations commerciales avec les États-Unis à revoir leur position. Cet accord conclu a, à l’instar d’autres nations, quelque peu inquiété et partiellement alarmé l’Union européenne (UE).
L’UE, bien qu’ayant dans un premier temps adopté une position ferme face aux États-Unis en élaborant un processus de négociation bilatéral et en préparant une liste de mesures tarifaires de représailles d’un montant de 93 milliards d’euros, n’a pas réussi à obtenir un consensus entre ses États membres sur cette liste. Ces derniers, tenant compte des dommages potentiels que cette liste de représailles pourrait causer au commerce mondial comme au commerce européen, ont majoritairement plaidé en faveur d’une voie de compromis.
L’accord préalable des États-Unis d’abord avec la Chine, puis avec le Japon, a quelque peu inquiété les États membres de l’UE, contraignant finalement celle-ci à adopter une approche de négociation plus constructive vis-à-vis de Washington. Ainsi, le dimanche 27 juillet, après de longues et difficiles discussions en Écosse du Nord, Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont annoncé un consensus et la conclusion d’un accord. L’UE a accepté que les États-Unis appliquent un droit de douane de 15 % sur les produits d’origine européenne, mettant ainsi fin à l’incertitude.
À la suite de cet accord, les responsables ont souligné qu’ils avaient choisi le moindre mal, rappelant que sans cet accord, l’UE aurait été soumise à un droit de douane de 30 %. Si certains au sein de l’UE ont présenté cet accord comme une victoire offerte à Donald Trump, l’Union européenne a, pour l’heure, évité une situation défavorable qui aurait pu plonger à la fois le commerce mondial et le commerce européen dans le chaos, en particulier avec son principal partenaire économique, les États-Unis. Dans ce contexte de négociation avec l’UE, il ne faut pas sous-estimer l’impact des accords soigneusement orchestrés que Trump a conclus avec la Chine et le Japon, ainsi que la pression exercée sur l’UE par ces démarches.
Bien que cette évolution semble avoir levé les obstacles qui pesaient sur le commerce de l’UE et le commerce mondial, il est probable que le sujet reste d’actualité dans les mois à venir, avec diverses répercussions à prévoir. Les blocs formés par les États-Unis avec la Chine et le Japon partagent la caractéristique d’avoir atteint un niveau avancé susceptible d’orienter le commerce mondial dans des secteurs clés tels que les voitures électriques, les technologies de l’information, l’industrie de la défense et l’intelligence artificielle. Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que l’UE est également en concurrence avec ces pays dans ces mêmes domaines.
Il convient également d’envisager cette question comme un enjeu commun entre les États-Unis et l’UE. Ainsi, l’accord récemment conclu et la suspension, pour l’instant, des négociations commerciales récurrentes entre les deux parties peuvent être perçus comme un signe favorable ouvrant la voie à l’émergence de nouvelles positions communes et à la mise en place de mécanismes conjoints face au bloc de l’Est.
Pour l’UE, les États-Unis représentent un marché majeur difficile à ignorer, avec près de 500 millions de consommateurs à fort pouvoir d’achat. Par ailleurs, certaines interdictions strictes imposées par l’UE sur des produits américains, notamment l’interdiction catégorique d’importer des produits laitiers, des denrées génétiquement modifiées, ainsi que les différends liés à la concurrence Airbus-Boeing ou aux négociations sur les boissons alcoolisées, constituent des sujets commerciaux sérieux et persistants entre les deux blocs. En y ajoutant les récentes avancées technologiques dans les domaines des voitures électriques et de l’intelligence artificielle, il est possible d’affirmer que l’UE, par cet accord, a temporairement évité un important blocage commercial.
Impacts potentiels sur la Türkiye
Impacts potentiels sur la Türkiye
Bien que les répercussions directes restent limitées, il est inévitable que ce processus ait des conséquences sur les exportations turques. Dans un premier temps, les mesures prises par l’UE, notamment contre les produits chinois tels que les voitures électriques, ont rendu la Türkiye attractive en tant que pays d’investissement, en facilitant l’accès des produits chinois au marché européen en contournant les barrières douanières et techniques. De grandes entreprises chinoises du secteur automobile ont ainsi entamé une recherche active d’investissements, et certaines ont déjà lancé leurs projets.
Dans ce contexte, la Türkiye a renforcé son attractivité en matière d’investissements et de relations commerciales. L’accord conclu entre les États-Unis et l’Union européenne pourrait également inciter la Chine à clarifier sa position dans les échanges mondiaux. Il est possible d’anticiper que les dynamiques en cours offriront à la Türkiye des perspectives favorables, en créant des conditions propices à un afflux d’investissements. L’accord entre Washington et Bruxelles doit par ailleurs être envisagé, cette fois, comme un nouvel enjeu stratégique pour les pays d’Asie de l’Est, tels que la Chine et le Japon, appelés à en tirer leurs propres conclusions économiques et diplomatiques.
Dans cette optique, la capacité de la Türkiye à suivre de près les évolutions en cours et à transformer efficacement sa position de pont entre l’Est et l’Ouest en un avantage stratégique à forte valeur ajoutée s’en trouve renforcée. Toutefois, une vigilance constante et une posture commerciale équilibrée à l’égard des deux blocs apparaissent comme des conditions indispensables pour tirer pleinement parti de cette configuration.
Dans une approche complémentaire, la Türkiye devra gérer avec une grande prudence la suite du processus, notamment dans le cadre de son appartenance partielle au système commercial de l’Union européenne à travers l’accord d’union douanière. De la même manière, il est essentiel que nos deux principaux partenaires commerciaux, les États-Unis et l’Union européenne, soutiennent la continuité des échanges dans une logique de coopération raisonnable et durable.
En définitive, le rapprochement positif entre les États-Unis et l’Union européenne contribuera, quoi qu’il en soit, à renforcer l’attractivité de la Türkiye. Il pourrait en particulier encourager des investissements plus significatifs et structurants en provenance de la Chine et d’autres pays d’Asie de l’Est.
Dans cette perspective, il est essentiel que la Türkiye suive avec la plus grande attention le processus de négociation commerciale entre Washington et Bruxelles, évalue les opportunités susceptibles d’en découler, et adopte une démarche proactive en développant de nouveaux arguments susceptibles de consolider sa position stratégique.
À lire également:
À lire également:
#Ömer Faruk Doğan
#Türkiye
#Turquie
#Commerce mondiale
#Économie
#USA
#UE
#Asie
AVERTISSEMENT JURIDIQUE
Le nom et le logo BIST sont protégés sous le "Certificat de Marque Protégée" et ne peuvent être utilisés, cités ou modifiés sans autorisation.Tous les droits d'auteur des informations publiées sous le nom BIST appartiennent entièrement à BIST et ne peuvent être republiés. Les données de marché sont fournies par iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. Les données des actions BIST sont retardées de 15 minutes.








